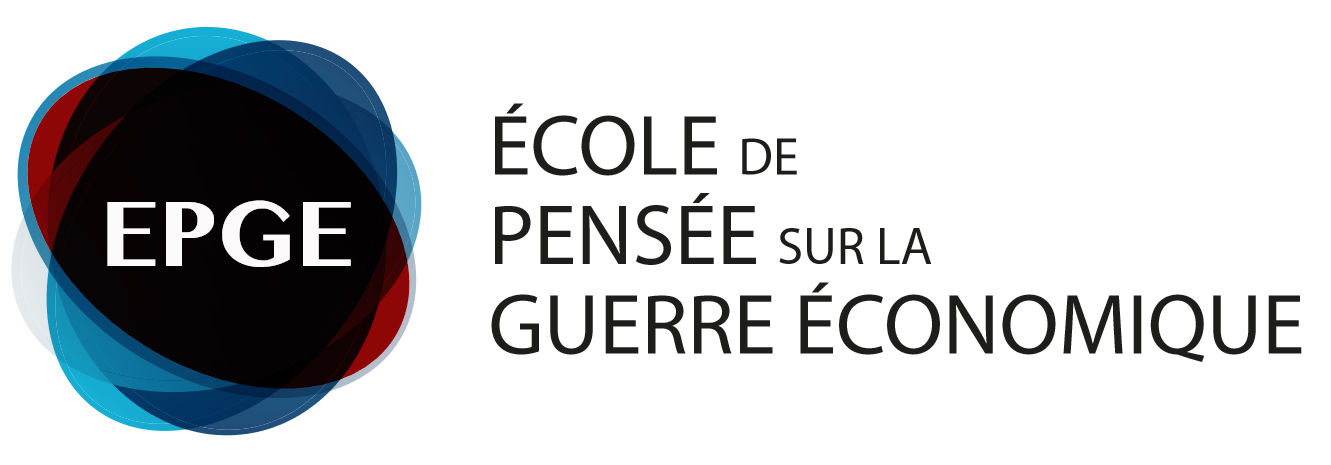Par Carlo de Cristoforis (cestudec centro studi strategici)
L’invasion russe de l’Ukraine, commencée en 2022, a repositionné la guerre militaire au centre du débat stratégique international, occultant temporairement l’importance des conflits économiques à l’échelle mondiale. Cette attention renouvelée au conflit militaire risque de créer une distorsion dans la compréhension des dynamiques contemporaines du pouvoir. On tend à considérer la guerre économique comme une simple extension des sanctions et des stratégies économiques d’urgence, ignorant son rôle plus large et systémique, capable de façonner les relations internationales en temps de paix.
La guerre en Ukraine et le retour de la polarisation militaire
Alors que la Russie cherche à se repositionner sur l’échiquier géopolitique, le conflit en Ukraine démontre que la force militaire reste un outil de pression, mais pas nécessairement le plus efficace. Le véritable affrontement se joue sur le plan économique : qui saura mieux exploiter les faiblesses structurelles de l’adversaire ? La question de savoir qui profitera finalement de cette guerre, tant sur le plan économique que politique, reste ouverte et souligne un paysage stratégique où les frontières entre conflit armé et guerre économique s’estompent.
La pensée de Clausewitz : limites et anachronismes
La vision de Carl von Clausewitz, définissant la guerre comme la continuation de la politique par d’autres moyens, a dominé la pensée stratégique militaire pendant des siècles. Cependant, l’école française de la guerre économique souligne que cette perspective est aujourd’hui dépassée face à la complexité des dynamiques globales. En se concentrant sur les guerres napoléoniennes, Clausewitz a négligé des facteurs économiques et sociaux déterminants pour le déclin de l’Empire français :
- Blocus économique britannique : L’encerclement naval imposé par le Royaume-Uni fut décisif pour isoler la France.
- Retard industriel : La France, par rapport au Royaume-Uni, n’était pas préparée à soutenir un effort de guerre prolongé.
- Légitimité politique : Le refus d’émanciper les peuples conquis, comme en Italie, a érodé le soutien local, rendant les conquêtes insoutenables.
Ces éléments montrent que le succès militaire ne peut être dissocié du contexte économique et politique. Les guerres de Napoléon, tout comme les conflits actuels, ne sont pas seulement le fruit de stratégies militaires, mais le résultat d’équilibres plus larges incluant l’économie, la politique et la légitimité sociale.
Leçons des guerres mondiales
Les deux guerres mondiales illustrent clairement les limites de la guerre militaire. La Première Guerre mondiale, avec son impasse stratégique et le massacre dans les tranchées, a démontré que le conflit militaire pouvait causer plus de dégâts que de bénéfices. La Seconde Guerre mondiale, bien qu’ayant redessiné l’ordre mondial, a marqué le déclin définitif des puissances européennes et le transfert de la domination mondiale aux États-Unis. Ces conflits montrent que la victoire sur le champ de bataille ne garantit pas un avantage durable si elle n’est pas accompagnée d’une vision économique et politique cohérente.
La guerre économique : une arme silencieuse mais décisive
Avec l’émergence de l’Union soviétique, le conflit entre blocs ne s’est plus limité à la sphère militaire. L’URSS a adopté une stratégie défensive basée sur la légitimation idéologique et la compétition économique avec l’Occident. Cette approche a culminé pendant la Guerre froide, où les armes économiques (sanctions, embargos, compétition technologique) se sont souvent révélées plus efficaces que les confrontations directes.
Aujourd’hui, la guerre économique systémique représente une nouvelle forme de conflit, où la force ne se mesure plus au nombre de chars, mais à la capacité de rendre les autres États dépendants. Les sanctions contre la Russie, par exemple, ne visent pas seulement à affaiblir son économie, mais à limiter son accès à des ressources stratégiques comme la technologie et les marchés énergétiques. La dépendance de l’Europe au gaz russe a également démontré comment l’économie peut être utilisée comme une arme de coercition.
La Chine et l’affrontement avec les États-Unis
Dans le grand jeu entre la Chine et les États-Unis, la guerre économique a pris une place centrale. Pékin évite le conflit militaire direct, se concentrant sur des stratégies économiques et technologiques pour consolider son influence mondiale. De leur côté, les États-Unis cherchent à contenir la Chine par un mélange de sanctions, d’alliances régionales et de pressions sur des questions sensibles comme Taïwan.
Cet affrontement montre que le champ de bataille du XXIe siècle est de moins en moins physique et de plus en plus numérique et financier. Le contrôle des réseaux 5G, l’accès aux terres rares et la suprématie technologique sont les véritables armes du pouvoir global.
Dépasser le paradigme militaire
L’obsession pour la guerre militaire, alimentée par les médias et les narrations dominantes, risque d’éclipser d’autres dynamiques stratégiques. La conquête militaire est désormais une exception plutôt que la règle. Le véritable défi réside dans le contrôle systémique, c’est-à-dire la capacité à influencer les secteurs clés de la vie sociale (énergie, technologie, culture) sans recourir à la violence.
Cette nouvelle forme de conflit, définie comme une guerre économique immatérielle, repose sur des outils tels que la manipulation de l’information, le contrôle des infrastructures numériques et l’accès aux données. C’est une guerre invisible, mais non moins dangereuse, qui redessine les équilibres de pouvoir sans qu’un seul coup de canon ne soit tiré.
L’approche de l’école française de la guerre économique, fondée par Christian Harbulot, nous invite à repenser le concept de conflit en dépassant la vision de Clausewitz pour se concentrer sur les dynamiques économiques et cognitives. La guerre militaire reste un outil, mais pas le plus efficace. Le véritable défi pour les puissances mondiales est de comprendre et de maîtriser les nouveaux champs de bataille : économiques, technologiques et informationnels. Dans ce contexte, le contrôle des dépendances économiques devient l’arme la plus puissante, capable de façonner l’avenir des nations sans tirer un seul coup de feu. Ce tournant méthodologique marque une révolution dans l’analyse des relations internationales et ouvre la voie à une compréhension plus systémique des conflits contemporains.