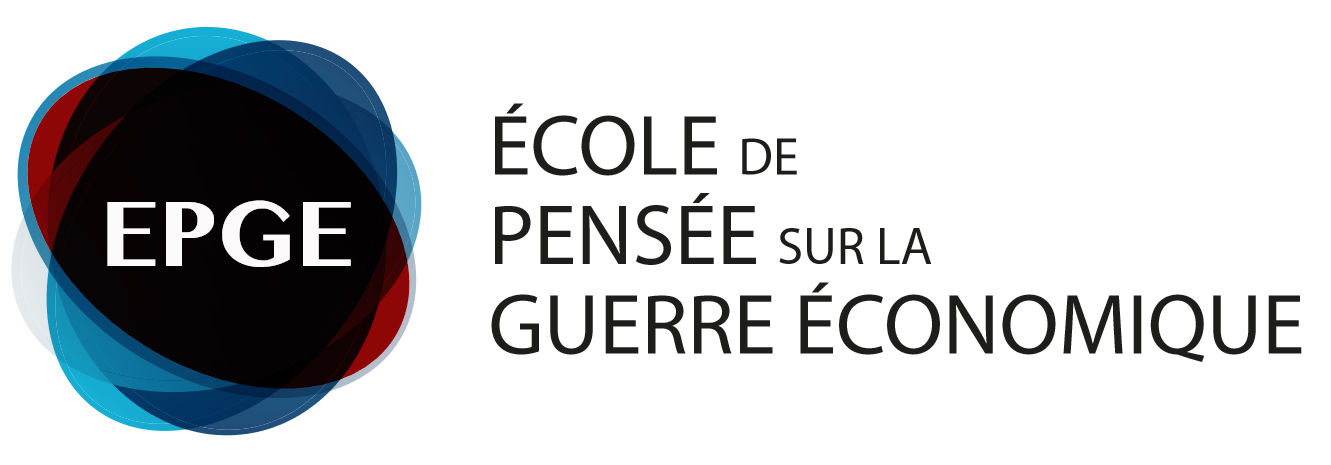Par Giuseppe Gagliano
La Chine représente l’un des acteurs géopolitiques les plus influents du XXIe siècle, mais aussi l’un des plus difficiles à comprendre. Son ascension, qui combine puissance économique, influence diplomatique et force militaire, est souvent perçue comme un phénomène inévitable et pacifique. Cependant, selon l’analyse proposée par l’École de Guerre Économique de Paris, l’expansion chinoise n’est pas simplement le résultat d’une croissance organique : c’est le fruit d’une stratégie méticuleuse qui intègre des éléments économiques, technologiques et politiques, conçue pour consolider sa domination à long terme.
La doctrine du développement pacifique : une façade aux nombreuses zones d’ombre
Lorsque la Chine évoque le concept de “développement pacifique”, elle se présente comme un acteur international rassurant, prêt à collaborer pour le bien commun. Le discours officiel met en avant le respect de la souveraineté des autres pays et le désir de contribuer à la paix mondiale. Pourtant, cette image est souvent en contradiction avec ses actions sur le terrain.
Un exemple frappant est l’initiative des “Nouvelles Routes de la Soie” (Belt and Road Initiative, BRI). Ce projet infrastructurel, qui concerne plus de 60 pays, est présenté comme un pont d’opportunités économiques, mais s’accompagne fréquemment d’accusations de “pièges de la dette”. De nombreux pays ayant adhéré à la BRI, tels que le Sri Lanka et le Pakistan, se sont retrouvés avec des dettes insoutenables qui les ont contraints à céder le contrôle de ports et d’infrastructures stratégiques. Le cas du port de Hambantota au Sri Lanka est emblématique : le gouvernement a dû le céder à la Chine pour 99 ans après avoir accumulé des dettes irrécupérables.
Parallèlement, Pékin a renforcé son contrôle sur les routes maritimes mondiales, essentielles au commerce international. Environ 30 % du commerce mondial transite par la mer de Chine méridionale, une zone que la Chine considère comme sa propriété exclusive, malgré les décisions internationales contestant ces revendications. La construction d’îles artificielles et leur militarisation sont des actes qui contredisent ouvertement la rhétorique de coopération pacifique affichée par Pékin.
La politique des raccourcis : une stratégie éprouvée et modernisée
La “politique des raccourcis”, qui consiste à accélérer le développement en acquérant des connaissances et des technologies extérieures, est une constante de la stratégie chinoise. Comme le souligne l’École de Guerre Économique, Pékin a repris et perfectionné une approche déjà utilisée par le Japon à l’ère Meiji et par la Corée du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la Chine a adapté cette stratégie aux dynamiques contemporaines, combinant des pratiques légales et des activités moins transparentes, comme le cyberespionnage.
Un exemple paradigmatique est le secteur aéronautique. La Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), soutenue directement par le gouvernement, a utilisé à la fois des collaborations internationales et des cyberattaques pour accélérer le développement du C919, le premier avion commercial chinois destiné à concurrencer les géants Boeing et Airbus. Depuis 2010, Airbus et ses sous-traitants ont été victimes de cyberattaques répétées attribuées à des groupes de hackers tels que Turbine Panda, liés au ministère de la Sécurité de l’État chinois. Ces attaques visaient à voler des données techniques sur les moteurs et les matériaux utilisés, réduisant ainsi les coûts de recherche et développement pour COMAC.
En outre, Pékin utilise des accords de coentreprise pour imposer le transfert obligatoire de technologies aux entreprises étrangères souhaitant opérer sur le marché chinois. Cette pratique, souvent critiquée par les entreprises occidentales, a permis à la Chine de développer rapidement des secteurs comme les télécommunications et les énergies renouvelables.
Le double langage chinois : une tradition stratégique
Le “double langage” de Pékin est une caractéristique récurrente de sa politique, basée sur un contraste entre la rhétorique publique et les actions réelles. Cette ambiguïté a des racines historiques profondes, déjà visibles pendant la Guerre froide. À cette époque, la Chine se présentait comme le champion de l’anti-impérialisme, tout en soutenant activement des régimes communistes et en menant des opérations militaires pour étendre son influence.
Aujourd’hui, ce double langage se manifeste dans les différends territoriaux en mer de Chine méridionale. Malgré ses déclarations officielles d’engagement pour la paix, la Chine a construit un véritable réseau de bases militaires sur des îles artificielles, équipées de radars, de pistes d’atterrissage et de missiles sol-air. Ces actions, bien qu’en violation des lois internationales, sont justifiées par Pékin comme des mesures défensives.
Un autre exemple est le secteur technologique. Alors que la Chine promeut la coopération internationale dans des domaines comme l’intelligence artificielle, elle utilise son potentiel technologique pour développer des systèmes de surveillance de masse et renforcer le contrôle interne. Des entreprises comme Huawei, accusées de collaborer avec le gouvernement pour des activités d’espionnage, représentent un point de friction croissant dans les relations entre la Chine et l’Occident.
L’aveuglement stratégique de l’Occident
La capacité de la Chine à progresser rapidement a été facilitée par l’aveuglement stratégique de l’Occident. Après l’effondrement de l’Union soviétique, de nombreux dirigeants occidentaux ont sous-estimé le régime communiste chinois, le considérant comme une relique vouée à disparaître. Cette conviction a conduit à une ouverture indiscriminée des marchés occidentaux au capital et à la production chinoise, sans considérer les conséquences stratégiques à long terme.
Un exemple concret est la pandémie de COVID-19. L’Europe et les États-Unis se sont retrouvés mal préparés pour gérer une crise sanitaire mondiale, en partie à cause de leur dépendance aux fournitures médicales produites en Chine. Masques, respirateurs et autres équipements essentiels étaient presque entièrement fabriqués en Asie, laissant les pays occidentaux vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.
La crise a mis en lumière un problème plus large : la délocalisation massive de la production industrielle vers la Chine a réduit l’autonomie stratégique de l’Occident dans des secteurs clés, le rendant dépendant d’un pays qui utilise l’économie comme un levier de pouvoir géopolitique.
Conclusions : un affrontement inévitable
L’analyse de l’École de Guerre Économique de Paris démontre que la Chine n’est pas simplement un acteur économique en plein essor, mais une puissance qui utilise l’économie comme un instrument d’influence globale. Son approche, fondée sur des stratégies de raccourcis, un double langage et un contrôle stratégique des ressources, représente un défi sans précédent pour l’Occident.
Pour relever ce défi, un changement radical de perspective est nécessaire. Les États-Unis et l’Europe doivent adopter des politiques économiques et technologiques visant à réduire leur dépendance à la Chine tout en promouvant une coopération interne renforcée. Seule une réponse coordonnée, basée sur une compréhension approfondie des stratégies de Pékin, pourra contrer l’influence d’un régime qui utilise le commerce et l’industrie comme des armes dans une guerre silencieuse mais implacable.