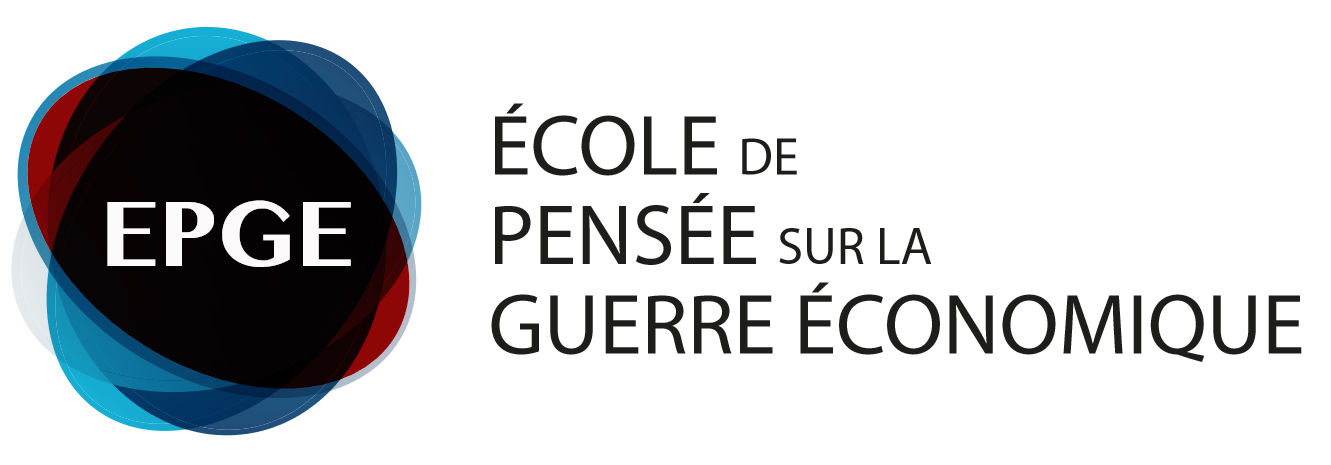Par Olivier de Maison Rouge
Avocat – Docteur en droit. Auteur de « Gagner la guerre économique », VA Editions, 2022 et « Les cyberrisques », LexisNexis, 2024.
Il est patent que la nouvelle doctrine américaine de l’Administration Trump ne fait que renforcer la crainte légitime d’un monde dit « VUCA » (acronyme anglo-saxon signifiant « volatile, incertain, complexe et ambigu »). Pour les entreprises, cela renforce le sentiment général d’incertitude et la difficulté à trouver un cadre apaisé dans un climat économique déjà dégradé.
L’élection de Donald Trump ne fait que renforcer cette inquiétude générale, accentuant les influences régionales tendant à une forme d’entre-soi multilatéral, où l’Occident au sens large, et son legs en droit international public est de plus en plus contesté par un Sud Global constitué des BRICS+ qui poursuivent depuis lors un autre agenda géopolitique.
Désormais, la frontière est de plus en plus ténue entre conflit armé et compétition économique exacerbée. De toute évidence, le monde qui a été édifié par les institutions internationales depuis 1945 s’efface. L’ONU ne remplit plus son rôle de règlement des conflits, l’OMC n’a plus la capacité d’arbitrer le commerce mondial (ses organes de règlement des différends sont tenus en échec), etc. Plus largement, l’esprit qui a présidé les relations internationales est passé successivement de la coopération, à la compétition et désormais à la confrontation.
A cet égard, le nouveau Président américain évoque ouvertement une guerre commerciale contre l’Europe, à coup de tarifs douaniers, tandis qu’il prétend à un expansionnisme sur le Canada, le Groënland et le Panama. Basé sur des motivations de sécurité des routes commerciales, le renforcement de la sphère d’influence US et l’accès aux terres rares, ce faisant il applique la doctrine Monroe du début du 20ème siècle (« l’Amérique aux américains ») et renoue parallèlement avec les expéditions de Theodore Roosevelt. Ce faisant, il faut donc s’attendre à une compétition exacerbée dans l’espace économique avec une velléité de renforcement des positions stratégiques américaines.
C’est donc un monde toujours plus conflictuel qui nous est promis. Mais en raison d’une économie mondiale très interconnectée, il nous est permis de songer à la réflexion de Raymond Aron : « Paix impossible, guerre économique probable ».
Or, un conflit armé interroge immanquablement le juriste car, contrairement aux idées reçues, il existe bien un droit de la guerre (I), pour partie codifié, mais aussi le fruit des usages que rassemblent les conventions de Genève, notamment, et qui constitue ce que l’on nomme le Droit international humanitaire (ou DIH – traitant du sort des prisonniers de guerre, des forces combattantes, des populations civiles …). Il convient donc de s’interroger afin de savoir si l’espace économique est en lui-même un lieu de conflictualité, auquel la pertinence d’un droit de la guerre économique peut se poser (II).
Dès lors, peut-on considérer que la guerre économique, qui constitue réellement un affrontement caractérisé, est un conflit de nature conventionnelle susceptible de s’inscrire dans un conflit armé ?
I – Le droit de la guerre convoqué sur le théâtre des opérations
A – Le droit de la guerre « onusien »
Le droit des conflits armés est sans conteste en très grande partie règlementé depuis la fin du 19ème siècle. Il est globalement régi par l’ensemble des traités et accords adoptés sur fond des guerres mondiales. Il a été érigé autour de ce que l’on nomme le Droit International Humanitaire (DIH) qui en constitue la colonne vertébrale, consacré notamment par la Charte de l’ONU.
En cela, le Président de la Russie avait justifié en 2022 son intervention en Ukraine sur le fondement de l’article 51 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) laquelle disposition énonce :
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. (…) »
Ce faisant, Vladimir Poutine affirme, selon son interprétation, certes contestable, des textes, que les accords de Minsk de 2014 – qui avaient réglé provisoirement la question ukrainienne une première fois – ont été délibérément violés par l’Ukraine d’une part, et que celle-ci a sciemment engagé en février 2022 des hostilités dirigées contre ce que les Russes considèrent désormais comme des régions autonomes (notamment le Donbass) d’autre part.
Par conséquent, la Russie n’aurait fait que venir au secours de ces territoires qui auraient fait appel à la protection des forces russes.
A contrario, les pays occidentaux voient logiquement l’action militaire russe comme une grave atteinte au territoire national et la souveraineté ukrainienne.
Tout est affaire de point de vue sur le sujet ; in fine ce sont souvent les succès militaires, qui déterminent a posteriori le droit applicable. Vae victis. L’Histoire n’est à ce jour pas encore écrite, même s’il est patent que la Russie a d’ores et déjà durablement perdu son autorité internationale qu’elle avait âprement tenté de restaurer depuis vingt-cinq ans.
Mais ce faisant, elle met également en exergue les dissensions européennes, enfermées dans des compartiments plus ou moins atlantistes selon les inclinations des gouvernements des pays membres de l’UE.
En effet, les partis élus au Parlement européen, font état de désaccords majeurs, tandis que les États eux-mêmes craignent de se voir attribuer la qualité de cobelligérant et font assaut de nuance et de retenue malgré les prétentions françaises sur « l’envoi de troupes au sol » .
C’est en quelque sorte une « montée aux extrêmes » ainsi que l’avait décrit von Clausewitz. Et dès lors, chacun s’interroge sur sa part de responsabilité et jusqu’où placer le curseur pour ne pas le cas échéant se trouver emporté dans l’engrenage de la guerre.
C’est pourquoi ce n’est pas tant le droit international public de la guerre qui est interrogé, où seraient convoqués les grands traités communs et pluripartites à l’instar de l’ONU, OTAN etc., mais ce sont des accords bilatéraux de sécurité conclus séparément avec l’Ukraine que l’on voit poindre, traduisant une fois encore un monde fracturé entre Occident d’une part et BRICS+ d’autre part, et plus largement un mécanisme international de résolution des conflits en panne sur fond de déglobalisation.
B – Le recours à l’affrontement économique dans les conflits non armés
Ce qui est pour le moins intéressant dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien est le recours annoncé à la « guerre économique » par voie de sanctions décidées à l’échelle d’Etats et d’organisations internationales, au premier rang desquelles l’Union européenne, dont les effets semblent en réalité contre-productifs et se sont retournés contre les émetteurs de ces restrictions (inflation, systèmes économiques parallèles, contournements sur les produits pétroliers, etc.).
A défaut de s’engager sur le front militaire, la France avait répliqué par la voix de Bruno Lemaire, Ministre de l’économie et des finances, en annonçant vouloir contribuer à « l’effondrement de l’économie russe » en livrant « une guerre économique et financière ». Ce à quoi Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, s’était empressé de répondre que ce propos pouvait ouvertement être interprété comme étant une déclaration de guerre, obligeant les autorités françaises à rétropédaler immédiatement. L’emballement médiatique avait créé de manière hasardeuse l’éventualité d’une guerre totale, ce qui était imprudent.
Cela démontre néanmoins que si l’Occident – bien que n’étant pas unanime – condamne fermement l’agression dirigée contre l’Ukraine constituant une atteinte à l’intégrité du territoire européen (à prendre ici au sens d’Europe civilisationnelle et non en regard des seules pays membres de l’Union Européenne), les pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) n’entendaient pasentrer en guerre frontalement contre les armées russes, sauf à user de mesures alternatives.
En revanche, passés maîtres en la matière depuis plusieurs décennies, les États-Unis n’ont pas manqué d’engager des sanctions économiques directes et indirectes (gel des avoirs, interdictions de ventes d’armes, embargos, listes de personnes recherchées ou interdites sur le territoire, etc.) destinées à infléchir les belligérants slaves (Russie, Biélorussie, Tchétchénie) et davantage encore à vouloir affecter leur potentiel de guerre.
Cela eut notamment pour conséquence de favoriser l’exportation de son pétrole GNL à destination de l’Europe, en substitution du gaz russe. Si un cessez-le-feu sous l’autorité du 47ème Président Donal Trump est potentiellement envisageable, ce dernier ne renoncera pas aux sanctions qui favorisent ses exportations. La Russie sera alors réintégrée partiellement au concert des nations, mais laissées au ban des échanges économiques.
C – Le droit de la cyberguerre dans le cadre des conflits armés
Cette conséquence montre combien la guerre est comme le dieu Janus, susceptible de changer de visage, et présente par conséquent une nature particulièrement hydride là où les Russes usent de leur côté de cyberguerre en soutien à leurs forces armées. Ce conflit armé n’est donc pas strictement conventionnel.
De nombreuses organisations, entités, entreprises et même des ministères français ont été par ailleurs frappés par des cyberattaques coordonnées de grande ampleur. Parmi les vastes attaques numériques enregistrées, il est patent que certaines proviennent d’organisations étatiques ou paratétatiques. Ainsi, le cyber est devenu une arme offensive autant que défensive, au même titre que les autres armements.
A ce titre, le Manuel de Tallinn, rédigé par l’OTAN en 2013, définit une cyberattaque militaire comme étant :
« une agression armée lorsque l’emploi de la force atteint un seuil élevé en termes de degré, de niveau d’intensité et selon les effets engendrés : pertes en vies humaines, blessures aux personnes ou des dommages aux biens. »
Le Manuel est très clair sur le premier point. Pour les experts, les opérations cyber réalisées dans le cadre d’un conflit armé doivent respecter le droit des conflits armés, à l’exception de certains d’entre eux qui estiment que la connexion ne s’applique pas automatiquement à toutes les cyberattaques mais seulement à celles ayant un lien suffisant entre l’opération et les buts militaires.
La France a, pour sa part, reconnu disposer d’une capacité offensive dans ce domaine depuis 2008, ainsi que cela ressort du Livre blanc de la défense et la sécurité nationale de la même année. Celui de 2013 rappelle que les batailles peuvent désormais se livrer dans cinq espaces déterminés : terre, air, mer, extra-atmosphériques et cyber. Un commandement cyber (ComCyber) a depuis lors été institué en ce sens.
Les attaques informationnelles déterminent les nouvelles frontières d’affrontement depuis l’utilisation à grande échelle des bots et trolls rendant possible d’insinuer et/ou d’amplifier des messages convergents à destination d’une population par le canal des réseaux sociaux.
Des outils sont également développés pour neutraliser l’activité numérique d’un État et ainsi de « l’aveugler » en lui coupant tous services de communication électronique affectant les GPS, accès à Internet… Une entreprise privée comme StarLink et sa constellation de satellites mis en orbite par Space X a été mobilisée pour les communications électroniques des forces armées et l’imagerie du théâtre des opérations. Elon Musk, son fondateur, avait provisoirement coupé les accès aux forces ukrainiennes de crainte d’être perçu comme belligérant. La lutte se livre également sur l’accès aux câbles sous-marins qui relient les réseaux informatiques d’un continent à l’autre.
De tels cyber affrontements, réels ou présumés – outre la difficulté à attribuer ces attaques, aucun État n’a reconnu avoir utilisé cette arme – ont conduit l’ONU à se pencher sur cette question. Le groupe des experts gouvernementaux constitué à cet effet a conclu en 2013 que le cyberespace devait être régi par les droits internationaux identiques aux autres espaces, malgré ses spécificités propres. Ainsi, toute attaque informatique constatée en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies précité autorise la légitime défense pour la partie agressée.
De même, des ripostes et contremesures de moindre intensité sont prévues en cas de cyber incidents constatés. La proportionnalité doit prévaloir dans l’usage de la cyber force, de même que la nécessité. La difficulté réside, comme dans l’emploi des autres armes, de pouvoir déterminer et cibler l’adversaire sans affecter davantage (les « dommages collatéraux »). Les objectifs purement civils, autres que ceux participant à la cyberguerre, doivent être écartés.
Rappelons enfin à ce stade que s’il existe un accord international reconnu pour régir l’espace depuis 1966 et la convention de Montego Bay (1982) qui régit le droit de la mer, hormis les textes ci-dessus, les États n’ont jamais érigé d’accord mondial sur le cyberespace.
Notre propos ci-dessus démontre donc qu’il existe un droit des conflits armés largement documenté, qui peu ou prou faisait encore consensus récemment. Il faut encore énoncer les actes et sanctions à ce droit tel que définis par le Tribunal de Nuremberg (1945) à savoir :
- Les crimes contre la paix,
- Les crimes de guerre,
- Les crimes contre l’humanité.
II– Le droit de la guerre économique en temps de paix
Selon Olivier Babeau (in Le nouveau désordre numérique, Buchet Chastel, 2020) :
« L’économie est par essence un rapport de force. Certes, elle prend la forme de collaborations et d’échanges volontaires. Bien sûr, elle permet la paix. Mais elle reste au fond, pour paraphraser Michel Foucault à propos de la politique, « la continuation de la guerre par d’autres moyens » ».
Reste que ce que l’on nomme la « guerre économique » est un concept qui n’est pas largement reconnu ou mal discerné et évolue précisément dans un périmètre qui n’est pas juridiquement défini au vu des règles internationales. Elle profite de cet interstice pour prospérer.
A – Qu’est-ce que la guerre économique ?
Sur le plan doctrinal, la guerre économique ne doit pas se confondre avec la guerre à l’économie, telle que la destruction ou le sabotage, par des moyens armés, d’usines d’armement, de voies de communication, de sites aéroportuaires, des approvisionnements, des moyens de télécommunication, des infrastructures cyber, etc., lesquelles actions relèvent davantage de la guerre totale (Voir Jean TANNERY (1878-1939 à l’origine de la guerre économique, par Michaël Bourlet, in « Guerres mondiales et conflits contemporains », 2004/2, n° 214).
On peut néanmoins affirmer que les frontières entre les deux notions sont parfois poreuses et les deux concepts ne s’excluent pas mécaniquement ; ils peuvent même se cumuler car la guerre à l’économie peut se combiner avec un conflit armé dans un même objectif. Ils peuvent être complémentaires comme être sur un même continuum. La guerre à l’économie consiste à neutraliser les capacités de production, de communication et de transport de l’ennemi. Ce faisant, les dommages causés à l’économie est bien un acte de guerre.
La guerre économique n’est pas non plus la guerre à l’économie que les altermondialistes mènent dans leur velléité de renversement du libéralisme et de la finance sous toutes ses formes. Si la guerre économique n’empêche pas la remise en cause d’un modèle économique, elle ne se rattache pas aux contempteurs du capitalisme, sauf à en dénoncer les dérives. Enfin, elle n’est pas l’économie de guerre à savoir l’effort industriel des entreprises d’armement pour alimenter l’appareil militaire en armement, comme vu plus haut.
En réalité, la guerre économique prospère précisément en temps de paix et constitue l’affrontement géoéconomique des grandes puissances, à défaut d’employer des moyens armés. Elle serait même une alternative au conflit armé, constituée d’affrontements non codifiés et non armés dans l’espace économique. Elle suppose un recours essentiel aux stratégies indirectes et/ou asymétriques dont le droit, la fiscalité, les technologies, les normes environnementales, la « surcompliance », etc.
Elle demeure cependant un affrontement de volontés dans le champ économique, créant un rapport du fort au faible et sans déclaration de guerre préalable. Le bannissement des banques russes de la plate-forme de compensation électronique SWIFT en est l’illustration, tout comme les gels des avoirs financiers ou encore les embargos décrétés sur des armements et biens à double usage.
L’universitaire Frédéric Munier précise que : « La guerre économique peut tout d’abord être définie, au sens strict, comme une modalité de la guerre. Elle s’inscrit alors dans un contexte de conflit entre nations sous la forme d’actions de violence économiques : l’embargo, le boycott, des mesures de contingentement en sont des exemples parmi d’autres. Les armes économiques sont mises au service d’un projet politique, le plus souvent l’affaiblissement d’une cible. (…) Cette guerre économique s’apparente à une guerre par l’économie. »
Mais pour Pascal Boniface, « la guerre économique peut se définir par la mobilisation de l’ensemble des moyens économiques d’un Etat à l’encontre d’autres Etats pour accroître sa puissance ou le niveau de vie de ses habitants ».
B – La guerre économique par le droit ou le lawfare
Ce faisant, incontestablement, le droit est devenu un des champs de bataille de la guerre économique ; il en est aussi un front avancé et une arme.
« Nos compétiteurs font du droit une arme qu’ils dirigent contre nos intérêts pour leur assurer l’ascendant. Outil de l’hybridité, l’usage stratégique de la norme (ou lawfare) se décline suivant trois axes majeurs : l’instrumentalisation croissante par certains États de leur propre droit, en particulier à travers l’extraterritorialité ; l’utilisation, le détournement ou le contournement de la norme internationale ; et l’exploitation de vulnérabilités juridiques et judiciaires résultant de notre droit interne ou de nos engagements européens. »
Revue nationale stratégique, SGDSN, 2022
En effet, pour le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale (SGDSN), selon les propos de son secrétaire général Stéphane Bouillon rapportés par la publication périodique de la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD) La lettre d’information économique, l’usage stratégique du droit comme outil de puissance économique s’articule autour de trois approches :
- L’instrumentalisation par certains Etats de leur propre droit, à l’instar de l’extraterritorialité, mais encore l’interprétation de lois locales au détriment d’acteurs entrants ; pour la DRSD, si l’usage de l’extraterritorialité du droit n’est pas blâmable en soi dans tous les cas de figure, elle « peut devenir un puissant outil d’ingérence et de prédation lorsqu’elle s’applique sur la base de critères flous ou encore lorsqu’elle conduit un Etat à imposer ses normes directement à un autre Etat sans le consentement de ce dernier ».
- Le détournement de la norme internationale, en usant de l’influence juridique et diplomatique ; tel que rapporté par la DRSD « il s’agit de démarches d’influence afin, par exemple, de faire prévaloir une interprétation de certaines normes internationales existantes (…) ou encore d’influencer l’élaboration de ces normes dans des domaines encore peu régulés. ».
- L’exploitation de failles juridiques à l’étranger pour asseoir sa domination commerciale. Toujours selon la DRSD, « cela désigne l’instrumentalisation de nos juridictions par l’introduction d’actions en justice. Celles-ci sont rarement fructueuses, mais le but n’est pas tant d’obtenir un succès contentieux que de créer un effet d’intimidation ou de discrédit ».
Selon la délégation parlementaire au renseignement (DPR), dans son rapport de 2023 sur les ingérences étrangères, l’extraterritorialité est également particulièrement documentée.
Selon les parlementaires :
« c’est un trait caractéristique d’une forme de domination des États-Unis qui agissent unilatéralement sur le territoire d’États tiers sur le fondement de leurs lois internes ».
La délégation recense par ailleurs la règlementation ITAR, à savoir les règles qui régissent l’exportation – mais surtout la réexportation – d’armements vendus par les États-Unis ainsi que les technologies duales, à savoir les biens à double usage (BDU), civil et militaire. Ce faisant, les États-Unis se sont arrogés un « droit de suite », permettant d’opposer un veto à la revente de matériel à des pays estimés hostiles aux intérêts américains.
En qualité de « gendarme du monde » autoproclamés depuis 1991, ils dictent ainsi des choix diplomatiques de pays tiers et peuvent également bloquer des ventes de pays amis. Ce fut le cas pour la vente de missiles destinés à équiper les avions Rafale destinés à l’Égypte, la procédure ITAR en 2018 ayant frappé MBDA qui devait fournir les armements qui intégraient une puce électronique fournis à l’origine par un sous-traitant américain.
Pour la délégation parlementaire au renseignement :
« de telles règlementations créent des distorsions de concurrence et peuvent contraindre les entreprises concernées à divulguer, sous couvert de légalité, des informations confidentielles. (…) La création du parquet national financier et de l’Agence française anticorruption puis la loi Sapin II, ont répondu en partie à cette épée de Damoclès dirigée vers nos actifs les plus stratégiques. Pourtant, le risque demeure et il faut être vigilant à ce que certains cabinets de conformité anglo-saxons actifs au sein d’entreprises sensibles ne transfèrent pas hors de France les informations critiques auxquelles ils ont accès. »
Comme nous pouvons le constater, il est patent qu’indépendant des confits armés, et même plu souvent en parallèle, l’espace économique est investi d’un féroce compétition où les liens amis-ennemis ne sont plus nécessairement les mêmes. Les alliés peuvent se présenter comme étant de véritables contestataires – voire des opposants – sur le plan commercial. C’est une des profondes caractéristiques de cette guerre économique. Ceci doit en conséquence nous questionner.
C – La guerre économique est-elle une forme de guerre conventionnelle ?
Rappelons que les traités et accords internationaux ne désignent pas les armes et procédés propres à la guerre ; le droit en exclut ou encadre certaines : nucléaire, chimique, bactériologique. L’emploi de l’arme cyber – offensive ou défensive – est devenu un élément incontournable pour les armées modernes. Par voie de conséquence, le droit de la guerre n’obéit pas à une classification stricte des armements.
En revanche, pour revenir à la charte de l’ONU, il est expressément prévu une graduation dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être infligées à un pays fauteur de guerre. À cet égard, l’article 41 prévoit que le Conseil de sécurité peut décider diverses mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée :
« Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. ».
Ce n’est qu’après avoir épuisé ces actions qui se seraient révélées infructueuses, que le recours à la force armée peut être utilisé afin de restaurer la paix. Cela signifie que les mesures de « guerre économique » s’appliquent en amont de l’emploi des armes, durant un temps qui n’est pas encore la guerre à proprement parler.
À ce titre, Jean-Vincent Holeindre estime :
« Alors que le droit de la guerre n’interdit pas de tuer, mais encadre l’usage de la force. A mon sens, l’économie est plus proche de la paix que de la guerre. »
Pour autant, il ne faut pas oublier que bien souvent les mesures de guerre économique, à l’instar de celles exprimées par Bruno Lemaire, s’appliquent également en temps de guerre pour affaiblir et contraindre l’adversaire. Dès lors, la guerre économique s’applique tout autant en période de conflit et s’intègre à la guerre totale comme l’a précisément supposé Dimitri Medvedev.
En conséquence de quoi, l’économie s’inscrit dans le champ du droit de la guerre à défaut de régir un droit à la guerre économique.
C’est en ce sens que s’était exprimé le juriste allemand Carl Schmitt à l’aube de la seconde guerre mondiale :
« Le passage à la guerre totale consiste dès lors en ceci que des secteurs extramilitaires de l’activité humaine (l’économie, la propagande, les énergies psychiques et morales des non-combattants) sont engagés dans la lutte contre l’ennemi. Ce dépassement du plan exclusivement militaire entraîne non seulement un élargissement quantitatif, mais encore une promotion qualitative. C’est pourquoi loin d’atténuer l’hostilité, il la renforce ».
L’avenir qui se dessine – qui traduit inévitablement la fin d’un monde unipolaire – doit dès lors nous interroger plus que jamais et nous conduire à redéfinir les lignes d’affrontement et de compétition dans l’espace économique dès lors que le droit antérieur ne prenait pas suffisamment cette dimension ou, à tout le moins, ne l’avait pas nécessairement intégré dans un cadre de contestation désormais prégnant à l’échelle internationale.